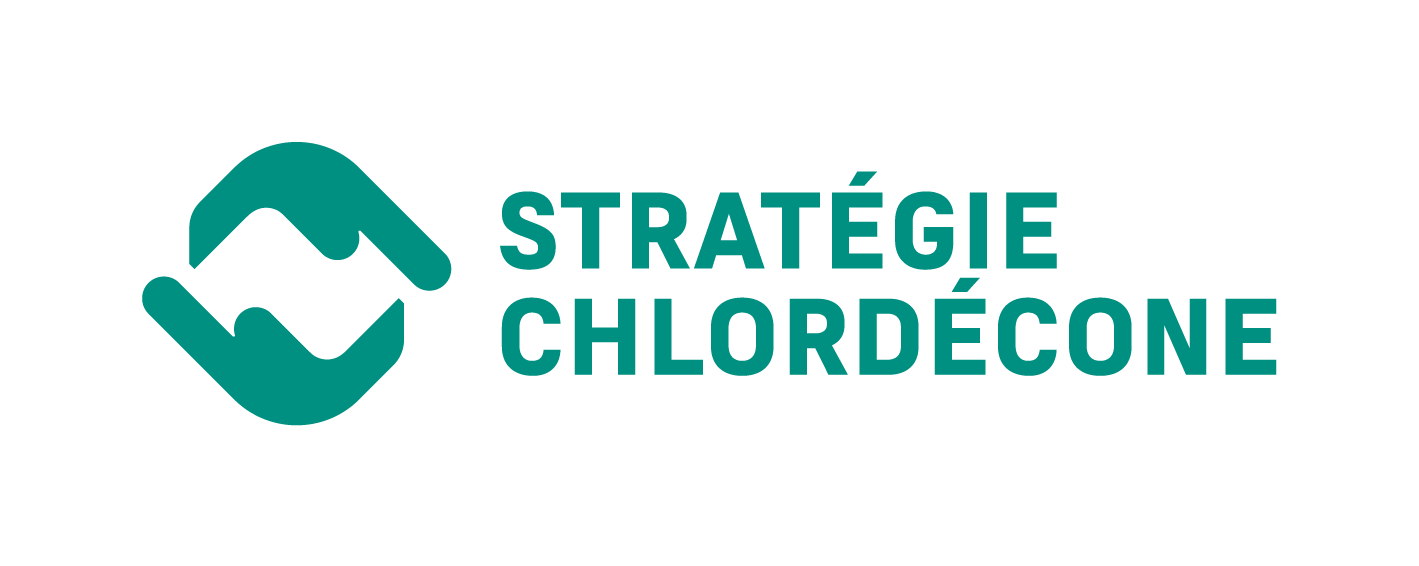Différents types de traitements peuvent être envisagés pour décontaminer des sols :
- Le confinement : mise en place d'une barrière empêchant les transferts entre la source de pollution et le milieu environnant,
- Le traitement " ex-situ " : les terres polluées sont excavées et traitées dans un centre extérieur au site,
- Le traitement " on site " : les terres polluées sont excavées, traitées par une unité mobile sur le site et remises en place,
- Le traitement " in-situ " : mis en oeuvre directement dans le sol pollué, le traitement peut être biologique (action des bactéries mais aussi d'autres organismes microscopiques et macroscopiques dont les végétaux), chimique ou physique (combustion, ventilation…).
La phytorémédiation consiste à utiliser de la végétation pour le traitement « in situ »des sols, des sédiments et des eaux contaminés par des polluants organiques comme le chlordécone ou inorganiques (métaux, minéraux…). Ces polluants peuvent être captés par les racines des plantes où ils vont être séquestrés et/ou dégradés. La technique de prélèvement/translocation par les plantes est l’une des voies de phytorémédiation des sols contaminés par les molécules organiques. Dans ce cas, le passage du polluant du sol dans la plante se fait par transport du sol vers les racines et est transloqué par la plante vers ses différents organes. Le polluant est ensuite transformé dans les tissus végétaux ou encore volatilisé dans l’atmosphère. Le processus de prélèvement/translocation est influencé par la taille des molécules, les propriétés du sol (taux d’argile et de matière organique, pH) et les espèces et variétés de plantes utilisées.
Les polluants lipophiles, comme le chlordécone, présentent la particularité de ne pas être facilement transloqués au travers des parois des cellules végétales. Ils sont donc peu incorporés à l’intérieur des plantes. Ces polluants lipophiles peuvent cependant atteindre des concentrations élevées dans les plantes du fait de l’adsorption préférentielle du sol sur la surface des racines et des tiges. Cependant les travaux réalisés par l’Inra et le Cirad montrent qu’il n’y pas de bioconcentration du chlordécone par les plantes (tableau ci-dessous), c'est-à-dire que les concentrations mesurées dans les plantes ne sont pas supérieures à celle du sol. Ainsi, le madère (dachine), légume dans lequel on mesure les niveaux de chlordécone les plus élevés, ne pourrait permettre une extraction de la molécule du sol qu’en plusieurs siècles.
|
Produits non pelés (analysés entiers) |
Contamination maximale observées (janvier 2006) mg/kg de produits frais |
Contamination du sol mg/kg de sol sec |
| Patate douce | 0,3 | 2,25 |
| Madère/Dachine | 0,23 | 1,4 |
| Igname | 0,069 | 2,25 |
| Navet | 0,04 | 1,51 |
| Radis | ,0,055 | 0,41 |
Toutefois, plusieurs travaux ont mis en évidence un certain potentiel des légumes de la famille des cucurbitacées (courgettes, citrouilles, melon) à extraire et à transloquer certaines molécules hydrophobes persistantes (DDT et dioxines) à partir du sol. Des concentrations particulièrement élevées de molécules hydrophobes ont ainsi été mesurées dans ces plantes. Ces niveaux de concentration s’expliqueraient par la capacité de ces plantes à augmenter la disponibilité et la mobilité du polluant retenu dans le sol. Un premier essai sous serre est en cours (Inra-APC/SPV-Guadeloupe), pour comparer les prélèvements de chlordécone réalisés par une solanée (tomate) et une cucurbitacée (courgette) sur des sols fortement contaminés, et sous deux régimes hydriques différents.
La dégradation biotique ou biodégradation est l’ensemble des processus de dégradation d’un contaminant en sous-produits (métabolites) par l’action des microorganismes (bactéries, champignons...). Ce processus est destructif et il en résulte généralement une diminution de la concentration du polluant initial.
La biorémédiation est une technologie qui utilise les micro-organismes, pour réduire la toxicité des matières organiques à risques ou pour les transformer en matière non toxiques. Elle peut-être réalisée « in situ » ou « ex situ » Il existe deux types de bioremédiation : la biorémédiation intrinsèque et la biorémédiation augmentée. La bioremédiation intrinsèque s’appuie sur une bactérie qui est déjà présente dans le sol, et qui se nourrit des contaminants. Cette technique implique une stimulation des bactéries pour cibler la contamination grâce à différentes techniques. La biorémediation augmentée ou bio augmentation utilise un consortium de bactéries sélectionnées pour leur capacité à transformer les contaminants. Les bactéries sont introduites dans la zone contaminée et leur métabolisme est supporté grâce à des nutriments ajoutés.
La dégradation du chlordécone, par les microorganismes du sol, ne permet que de faibles taux d’élimination de la molécule et provoque la formation de produits de dégradation ayant une toxicité similaire à celle de la molécule mère.
L’application répétée de pesticides sur le sol peut conduire à l’adaptation de la microflore du sol qui acquiert la capacité de dégrader ces molécules. Aux Antilles, il semble qu’aucune sélection de micro-organisme capable de dégrader le chlordécone ne soit spontanément apparue dans les sols, malgré plusieurs décennies de présence de la molécule dans ce milieu.
Une recherche a été entreprise par l’Université des Antilles et de la Guyane (Sarah Gaspard, Equipe Covachim), en collaboration avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui en relation avec des chercheurs indiens a déjà sélectionné des bactéries capables de dégrader l’ hexachlorocyclohexane (HCH), un autre pesticide organochloré. D’autre part, des équipes internationales travaillant sur la thématique de la dépollution des sols seront consultées afin d’émettre des propositions de recherche qui seront soumises à l'ANR. Cet atelier se tiendra au cours du premier semestre 2009 aux Antilles.
En savoir plus :
- Cirad : consulter le site
- Inra : consulter le site
- Université des Antilles et de la Guyane : consulter le site